Le Ténement d’Ardalhon
En leurs personne Jean CANAU fils à Marien CANAUT, Pierre MARCHE, Marciien BOUDOL, Bonnet DENIS, Michel MARCHEIX tant en son nom qu’en qualité de tuteur des enfants de feu Guillaume MARCHEIX son frère, tous laboureurs habtitants du village des Tours paroisse de Miremont et Martige POUMEROL laboureur habitant du village de Moulliebé paroisse de Charensat.
A savoir : le Ténement appelé d’Ardailhon, composé de prés, terres et paschiers, fraux et communaux situés dans la paroisse de Saint-Priest que jouxte le Mas de la Chaumette de jour et bise, un chemin tendant du Pont du Bouschet à Auzances de midy, autre chemin teandant du village de Tours au Bladeix de nuit, aux cens annuels et perpétuels de la somme de quatre sols, ect…
Le Ténement du Blanquet
En leurs personnes Louis de BOSCAVERT, escuyer sieur du Bladeix habitant audit village et François TIXIER, laboureur habitant au village de l’Esbeaupin paroisse de Biollet.
A savoir, Situé dans la paroisse de Saint-Priest contenant entour dix septerées qui se confine jouxte le Mas du village du Bladeix de jour et bise, le chemin commun tendant du Pont du Boucheix à Auzances et au village de Lausbepin de midy, le Mas dudit village de l’Esbaupin de nuit, au cens annuels et perpétuels d’une quarte de seigle mesure de Termes, ect…
La moitié du village Mas et Ténement de Lesbaupin
En leurs personnes, Dlle Anna LARDIF veuve d’Henry de SERVIERES, vivant Écuyer, Seigneur de Couronnet, habitant audit Couronnet, laquelle de son bon gré et volonté, tenir et porter de tout temps et ancienneté [les] cens censive et directe seigneurie des dames abbesse et religieuses du couvent de l’Esclache ordre de Citeaux à cause de leur prieuré de la Roche situé dans la dite paroisse de Saint Priest membre dépendant de l’abbaye […] à savoir la moitié du village mas et tènement appelé Lesbeaupin de Pourradier et Gondol ou Goudard joignant ensemble situé dans la dite paroisse de Saint-Priest composée de maisons, granges, étables, jardins, prés, terres, paschiers, bois, buissons, fraux et communaux qui se confine jouxte les mas du Bladeix et de Blanquet de jour, un chemin commun allant du pont du Boucheix à Auzance de midi, autre chemin courant partant du village des Tours à Biollet de nuit, les terres de la Quarte Vieille et des Barsses de bise, au cens annuel et perpétuel pour la dite moitié dudit village et tènement de Lébeaupin de la somme de seize sols six deniers, seigle sept quartes et un quarton, avoine un septier et deux quartes, mesure de termes, une geline et demis censuel
La moitié du village Mas et Ténement de Lesbaupin
En leurs personnes, Dlle Anna LARDIF veuve d’Henry de SERVIERES, vivant Écuyer, Seigneur de Couronnet, habitant audit Couronnet, Maistre Jean PASSAVY prêtre demeurant au village de la Chaumette, Grégoire BODOL alias BOUDOL, Jean MAZON, laboureurs habitants du village de Lesbaupin paropisse de Saint-Priest, François TIXIER laboureur habitant du village de Lesbaupin paroisse de Biollet, Anna BESSE veuve d’Anthoine TEITARD de l’état de labeur habitante du village de Lesbaupin paroisse de Saint-Priest, lesquels de leurs bons gré et volontés ont reconnu être confessés, etc.…
La moitié du Mas et Ténement appelé de Lesbaupin de Pourradier et Goudol, composé de maisons, granges, jardins, prés, terres, bois, buissons, eaux, cours d’eaux, fraux et communaux, aux cens annuels et perpétuels pour ladite moitié de seize sols six deniers, seigle sept quartes, un quarton, avoine un septier demi quarte, mesure de Termes et une géline et demi… se confine et jouxte le Mas du Bladeix et de Blanquet de jour, un chemin commun tendant du Pont du Bouchet à Auzances de midy, un chemin commun tendant du village des Tours et Biollet, le Mas de la Quarte-Vieille et des Barsses de bise et partie de nuit dans lesquelles confinassions, est aussi englobée l’autre moitié du susdit village, Mas et Ténement de Lesbaupin…
Le Pré Mignot
En leurs personnes Maistre Gervais ROUDAYRE praticien résidant au village Termes paroisse de Biollet et Maistre Gilbert ROUDAYRE greffier de Pierre brune et Espinasse en qualité de tuteur des enfants feu Maistre Gervais ROUDAIRE son père et de Rose Marie CERCIRAY sa femme habitant du village de Villefranche paroisse d’Espinasse lesquels de leurs bons grés et volontés ….
Un pré appelé pré Mignot situé au lieu de Termes paroisse de Biollet contenant autour quatre journaux qui ce confine jouxte le chemin par lequel on va de Termes à la fontaine appelée Fontauvey de jour, la terre dudit Gervais ROUDAIRE de midy, les jardins des hoirs feux Antoine BARSSE et Pierre CUZY de bize, le chemin par lequel on va de Termes à Auzances et un communal le tout de nuit, au cens annuel et perpétuel de trois septiers blé seigle mesure de Termes.
Le Tènement du Treul ratification
En sa personne Maistre Louis de LAUSSEDAT praticien habitant du village de Laussedat paroisse de Saint-Priest-des-Champs, lequel de son bon gré et volonté et en vertu de procuration a lui donnée par Damoiselle Clauda BARTOMIVAT sa tante veuve de Jean LARDIF vivant écuyer Sieur des Barsses en qualité de tutrice de leurs enfants du trente mars dernier par ROUDAIRE Notaire Royal …
Terrier de La Roche partie 2
/http%3A%2F%2Fwww.geneatique.com%2Fuploads%2Fimages%2Fbanniere%2Fchoisi-200x200.png)
Terrier de La Roche en 1683 (Partie 2) - Le blog de jacot63
Le Pré Desparry et du Moully En leurs personnes, Vénérable personne Maistre Henry BARSSE, prêtre et curé d'Ayat y résidant et Jean DESMOLLINS, laboureur habitant du village de la Roche, tous ...




/image%2F0553134%2F20230511%2Fob_0a0fb5_img-1871.JPG)
/image%2F0553134%2F20230420%2Fob_4d5287_la-roche1.jpg)
/image%2F0553134%2F20230420%2Fob_cbadb7_la-roche2.jpg)
/image%2F0553134%2F20230420%2Fob_ba434a_la-roche3.jpg)
/image%2F0553134%2F20230420%2Fob_c675be_la-roche4.jpg)
/image%2F0553134%2F20230420%2Fob_e2d93c_la-roche5.jpg)
/image%2F0553134%2F20230405%2Fob_4ed936_1466-1469.jpg)
/image%2F0553134%2F20230405%2Fob_a29101_1577-1578.jpg)
/image%2F0553134%2F20230405%2Fob_724460_la-roche1.jpg)
/image%2F0553134%2F20210524%2Fob_88a8d4_armoiries-boscavert.JPG)
/image%2F0553134%2F20210303%2Fob_1c14ee_petite-verole-tableau.JPG)
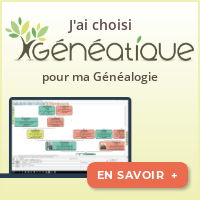 ">
">
